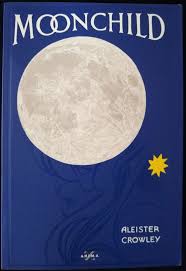Les films de Sam Peckinpah se rangent, semble-t-il, pour les
cinéphiles, en deux catégories. On distingue d’une part les œuvres majeures,
comme La horde sauvage et son final ultraviolent qui a marqué
durablement l’histoire du 7e art, ou encore Les chiens de paille qui
voit un petit mari timide se transformer en tueur implacable face à une troupe
de violeurs alcooliques irlandais. Face à ces monuments, on range volontiers
dans la catégorie des « films mineurs », des œuvres telles que Apportez-moi
la tête d’Alfredo Garcia ou Convoy. On retrouve toujours chez
Peckinpah une fascination pour les déclassés en tout genre et les outlaws de
tout poil. Dans La horde sauvage, il s’agit du ramassis de gangsters
rassemblé autour de la figure de Pike Bishop
tandis que dans Apportez-moi la tête d’Alfredo Garcia, une troupe
hétéroclite de tueurs de bas étage et de malfrats médiocres se pressent, voire
s’entretuent, pour retrouver la tête d’Alfredo Garcia, défunt amant de la fille
du terrible El Jefe.
Dans Convoy cependant, on ne trouvera ni outlaws
sanguinaires, ni desperados sans foi ni loi, mais toujours des déclassés de la
société américaine : une poignée de chauffeurs routiers, Martin ‘Rubber Duck’
Penwald, Bobby ‘Love Machine’, ‘Pig Pen’, ‘Spider Mike’, qui sillonnent les
autoroutes désertes de l’Arizona et qui se trouvent en butte à l’hostilité d’un
shérif local, incarné par un vieil habitué des productions de Peckinpah,
Ernest Borgnine. Avec ce personnage, le film prend déjà un tour gentiment
politisé et anarchiste. Borgnine est l’incarnation non pas de la loi mais de
l’arbitraire. Il est à la fois injuste, corrompu et violemment déterminé, au
point de passer à tabac ‘Spider Mike’, un des amis du ‘Rubber Duck’, tombé
entre ses griffes.
Face à ce peu recommandable représentant de la loi, ‘Rubber
Duck’, ‘Pig Pen’ ou ‘Spider Mike’ campent des figures d’américains moyens, de
rudes mais honnêtes travailleurs. Ils symbolisent une Amérique des gens
simples, des motels, des relais routiers, une Amérique telle que Christopher Lasch
a pu la rêver, « une nation d’égaux, travailleuse et démocratique, pour qui la
réussite ne résidait pas dans la promotion sociale. Un mythe aujourd’hui très
lointain, mais qui, comme tout mythe, garde une puissance évocatrice capable
d’ébranler l’arrogance du colosse d’argile américain. »
Les héros de Peckinpah ne sont pas des self-made men avides de profit,
ils n’incarnent pas ce modèle de réussite capitaliste et tapageuse qui a
tellement su séduire nos élites les plus vulgaires. Ces conducteurs de poids-lourds
tiennent plus du cow-boy, ou du gaucho sud-américain. Ce sont des hommes
avant tout épris de leur indépendance et de leur liberté. Ils font partie de
ceux qui, dans cet envers rural et désertique de l’Amérique conquérante et
ultra-consumériste que représente encore le grand ouest, contribuent à
perpétuer le vieux mythe fondateur de la frontière et les valeurs de l’Amérique
aventureuse et volontiers réactionnaire des rednecks, des white trash et
des sympathiques laissés pour compte et artisans de la grandeur de l’Empire. Guns
and guts made America great.
Cet univers, Peckinpah le dépeint avec tendresse et l’oppose
même assez schématiquement à la brutalité bornée de la police locale. La
démonstration est peu nuancée, mais au fur et à mesure que se déroule
l’histoire de Convoy, le film acquiert une profondeur que les premières
séquences ne laissaient pas forcément soupçonner. Alors, en effet, que nos
sympathiques routiers sont poursuivis par la haine tenace du shériff, ils
commettent l’imprudence de faire halte dans un snack local pour profiter d’une
bière et de la généreuse tendresse des serveuses de l’établissement. La
confrontation entre les routiers au repos et les sbires de la police locale,
venus les harceler jusque dans leur modeste havre de paix, donne à Peckinpah
l’occasion d’orchestrer une scène de bagarre de bar digne des plus grands
moments de Bud Spencer et Terrence Hill. La scène de poursuite qui s’ensuit,
alors que les camionneurs fuient le restaurant ravagé, rappellera quant à elle
aux amateurs les cascades burlesques de Shérif fais-moi peur. Peckinpah
use et abuse du procédé du ralenti, qui est devenu avec le temps sa marque de
fabrique : on voit même après une poursuite homérique se terminant pour
l’un des protagonistes à travers un panneau publicitaire, un des conducteurs,
frapper de dépit sur le capot de son véhicule hors d’usage au ralenti.
Si Convoy ne se résumait qu’à des bagarres de bar dans
le style bouffon et à de baroques scènes de poursuites, il ne resterait malgré
tout qu’une œuvre, moins que mineure, parfaitement dispensable. Or, le film
prend tout son sens et toute son ampleur à compter du moment où les quatre
protagonistes principaux, ‘Rubber Duck’, ‘Love Machine’, ‘Pig Pen’ et ‘Spider
Mike’, décident de foncer à bord de leurs camions vers la frontière du Nouveau
Mexique où ils espèrent enfin pouvoir échapper au constant harcèlement de la
police locale. A partir de là commence un road movie sans véritable
équivalent dans l’histoire du cinéma américain. Tandis que les fugitifs tentent
d’échapper à leurs poursuivants, les manifestations de solidarité et les
encouragements grésillent sur les CB. Au fil des kilomètres, d’autres routiers
se joignent au convoi emmené par le charismatique ‘Rubber Duck’. Ce sont
bientôt cinq, puis dix, vingt, cinquante véhicules qui se ruent en file serrée
et à tombeau ouvert sur les highways du grand ouest américain. L’objectif
premier des fugitifs, rallier le Nouveau Mexique, semble soudain devenu
secondaire. Le convoi devient un symbole, un mouvement contestataire qui
rassemble les participants les plus enthousiastes et les véhicules les plus
hétéroclites : monstres de métal sur dix-huit roues, transport de bétail,
de produits chimiques, car scolaire emmenant une congrégation religieuse hippie
et même un véhicule agricole épandeur d’eau.
Le gouvernement fédéral, averti de l’épopée héroïque de cette
version chromée et motorisée de la longue marche, tente d’abord d’employer la
force pour l’arrêter et capitule quand il s’avère que le camion du ‘Rubber
Duck’ lui-même transporte des matériaux instables que la moindre balle
risquerait de faire exploser sous l’œil des caméras embarquées des véhicules de
télévision qui se sont joints au convoi. La tentative d’interview menée par un
reporter juché sur le plateau arrière d’un pick-up avec son caméraman et qui se
porte à la hauteur du camion de ‘Rubber Duck’ pour l’interroger donne
d’ailleurs lieu à l’une des plus belles scènes du film. Qui se cache derrière
ce pseudonyme, ‘Rubber Duck’, demande le journaliste, un syndicaliste ? Un
révolutionnaire ? Un leader politique ? Personne, répond l’intéressé.
Juste un type ordinaire. Et que veut ce type ordinaire ? Quelles sont ses
revendications ? demande encore le reporter. Aucune, rétorque ‘Rubber Duck’. « Je
conduis, c’est tout. » Devant l’insistance du reporter à obtenir des
réponses plus précises, ‘Rubber Duck’ fait alors un geste vague en direction de
la cinquantaine de véhicules qui le suivent : « Demandez-leur à eux
pourquoi ils me suivent, ils vous le diront ! »
La scène qui suit démontre qu’il ne faut jamais négliger les
films mineurs des grands cinéastes car ils réservent quelquefois de véritables
trésors. Le reporter et le véhicule de télévision, suivant l’injonction du
‘Rubber Duck’, entament une longue descente le long de la colonne de véhicules,
filmant et interrogeant chaque conducteur sur ses revendications et les
motivations qui l’ont poussé à rejoindre cette manifestation mécanique
improvisée et la longue cohorte des protestataires. Le plan est admirable, il
constitue à la fois une mise en abyme cinématographique et une critique
virulente de la société américaine. Le véhicule du reporter descendant
lentement le long de la colonne de poids lourds filme de cabine en cabine une
succession de saynètes dans lesquelles chaque interviewé, au volant de sa
machine, se tourne vers la caméra et exprime ses revendications. Pendant dix
minutes de ce micro-trottoir improbable, Peckinpah laisse s’exprimer l’Amérique
des déclassés, des travailleurs qui
abandonnent femmes et enfants au foyer pour sillonner les routes, de tous les
modestes oubliés du rêve américain. Du prix de l’essence aux humiliations
infligées par les forces de l’ordre, de la frustration de l’armée des laborieux
à la colère de l’ancien combattant du Vietnam, des revendications des noirs
américains au désespoir de l’ouvrier jeté hors de son usine, tout y passe.
Peckinpah réussit en une scène le tour de force de donner soudain une voix à
tous ces anonymes, cette voix qui éructe tout au long du film en arrière-plan
sur les postes radios des camions des blagues salaces, des provocations
libertaires et des confessions désenchantées dans un langage codé que les
autorités essaient sans succès de déchiffrer. Il ne reste plus à ces individus
déracinés et brinquebalés d’un bout à l’autre du pays par une impitoyable
logique économique que cette voix portée par les ondes, que ces codes qui leur
appartiennent et que leurs camions qui deviennent, réunis dans ce convoi,
l’arme de leur colère.
On pourrait croire à lire ceci que Convoy s'apparente à une
œuvre marxiste. Ce n’est pas le cas. Le film de Peckinpah est populiste dans le
sens premier du terme, celui que Vincent Coussedière se réapproprie dans son
excellent essai, Eloge du populisme, publié très récemment aux éditions
Voies Nouvelles, c’est le populisme qui dressait aux Etats-Unis dès le XIXe
siècle des ouvriers, des paysans ou des artisans contre le pouvoir des trusts,
le populisme des révolutionnaires pré-bolcheviques en Russie à la même époque
ou le populisme des luddites en Angleterre ou des Canuts en France qui se
révoltent au début de la révolution industrielle contre cette idéologie
dévoreuse d’hommes qui guide déjà le premier capitalisme. C’est ce populisme,
explique aujourd’hui Coussedière, qui donne à ce peuple turbulent qui échappe
par essence à toute définition idéologique, politique, ethnique ou sociologique
systémique, la volonté de défendre sa propre définition du bien commun contre
les empiétements de toutes sortes dans un mouvement profondément libertaire que
les prophètes de la modernité s’empressent de qualifier de réactionnaire et
dont les démagogues essaient toujours de tirer profit.
Ce populisme-là, que Vincent Coussedière distingue avec
raison dans son petit essai de la démagogie, Sam Peckinpah en donne dans Convoy
une superbe évocation cinématographique. Dans l’une des scènes du film, un rusé
politique tente d’approcher celui qu’il identifie comme le meneur du mouvement,
le ‘Rubber Duck’, incarné par un Kris Kristofferson qui trouve là un rôle à la
mesure de ceux qu’il incarnera dans Pat Garrett et Billy le Kid ou La
porte du paradis. Aux promesses du démagogue, le ‘Rubber Duck’ oppose la
même réponse qu’au reporter un peu plus tôt : « Je ne vais nulle
part, je ne mène personne, ceux qui le veulent se contentent de me
suivre. » Le véritable populisme réside d’abord dans cette capacité de
refus et dans cette reconquête d’une liberté railleuse, belliqueuse et ennemie
de tout système, de l’anarchisme en somme.
Sam
Peckinpah. Convoy (Le convoi). 1978
Vincent Coussedière. Eloge
du populisme. Editions Voies Nouvelles. 2012. 16 €