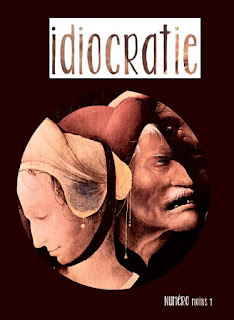« Le beau n’est que le premier degré du terrible » (Rainer Maria Rilke)
 La
poétesse argentine Alejandra Pizarnik, dont l’œuvre est désormais intégralement
édité par les Ypsilon.editeur, vécut
à Paris de 1960 à 1965. Elle y fut notamment l’ami d’André Pieyre de
Mandiargues qui l’introduisit dans le milieu littéraire. Leur amitié sera
l’occasion d’une longue correspondance qui poursuivra plusieurs années après le
retour de Pizarnik à Buenos Aires jusqu’à son suicide en 1972. La postface de
Mariana Di Cio évoque « Un dialogue
intense qui se tisse autour d’affinité électives, des coïncidences esthétiques
qui se déclinent et s’accentuent au rythme des visites et des promenades
nocturnes, mais aussi des blancs et des non-dits qui coexistent avec des
lectures partagées… » La lecture de ces lettres nous semble appeler un
jugement plus nuancé quant à la nature de cette relation ou du moins, à scruter
avec attention ces « blancs » et ces « non-dits ».
Les deux écrivains ont indéniablement des points communs : même goût pour
l’érotisme, Sade, Lautréamont, Rimbaud, Michaux. Pourtant,
si leur amitié fut réelle, il nous paraît abusif de l’envisager sous l’ange
d’une parfaite communion d’esprits. L’ensemble laisse surtout une impression
d’inachèvement dont on devine que la mort prématurée de la poétesse n’est pas
la seule cause. C’est un dialogue aimable, parfois chaleureux, mais souvent
superficiel au point qu’on en vient à se demander si Mandiargues, malgré sa
gentillesse et sa culture, était l’interlocuteur idoine pour Alejandra
Pizarnik. Une grave question s’impose naturellement : a-t-il vraiment
compris son œuvre ? Elle vient à l’esprit suite à cette stupéfiante définition
qu’il propose de ses poèmes :
La
poétesse argentine Alejandra Pizarnik, dont l’œuvre est désormais intégralement
édité par les Ypsilon.editeur, vécut
à Paris de 1960 à 1965. Elle y fut notamment l’ami d’André Pieyre de
Mandiargues qui l’introduisit dans le milieu littéraire. Leur amitié sera
l’occasion d’une longue correspondance qui poursuivra plusieurs années après le
retour de Pizarnik à Buenos Aires jusqu’à son suicide en 1972. La postface de
Mariana Di Cio évoque « Un dialogue
intense qui se tisse autour d’affinité électives, des coïncidences esthétiques
qui se déclinent et s’accentuent au rythme des visites et des promenades
nocturnes, mais aussi des blancs et des non-dits qui coexistent avec des
lectures partagées… » La lecture de ces lettres nous semble appeler un
jugement plus nuancé quant à la nature de cette relation ou du moins, à scruter
avec attention ces « blancs » et ces « non-dits ».
Les deux écrivains ont indéniablement des points communs : même goût pour
l’érotisme, Sade, Lautréamont, Rimbaud, Michaux. Pourtant,
si leur amitié fut réelle, il nous paraît abusif de l’envisager sous l’ange
d’une parfaite communion d’esprits. L’ensemble laisse surtout une impression
d’inachèvement dont on devine que la mort prématurée de la poétesse n’est pas
la seule cause. C’est un dialogue aimable, parfois chaleureux, mais souvent
superficiel au point qu’on en vient à se demander si Mandiargues, malgré sa
gentillesse et sa culture, était l’interlocuteur idoine pour Alejandra
Pizarnik. Une grave question s’impose naturellement : a-t-il vraiment
compris son œuvre ? Elle vient à l’esprit suite à cette stupéfiante définition
qu’il propose de ses poèmes :
« Ce sont de jolis animaux un peu
cruels, un peu neurasthéniques et doux ; ce sont de très jolis animaux
qu’il faut nourrir et choyer ; ce sont de précieuses petites bêtes à
fourrure des sortes de chinchillas peut-être, à qui il faut donner son sang de
luxes et de caresses… »
Voilà
les fragments nocturnes de Pizarnik, par la magie surréaliste, transformés en
précieux animaux de compagnie ! Paradoxalement, le malentendu se révèle à
mesure que croît leur complicité. En confiance, Pizarnik donne libre cours à
son naturel sauvage et fantasque, exprime, parfois crûment, sa difficulté
d’être, pose son ton: « Pas ma voix qui s’efforce de ressembler à une voix
humaine mais l’autre qui témoigne que je n’ai pas cessé d’habiter dans les
bois ». Ce malentendu apparaîtra dans
toute son ampleur à l’occasion de l’hospitalisation de Pizarnik suite à une
tentative de suicide. Mandiargues restera alors longtemps silencieux. Elle
implorera une réponse qui lui parviendra quelques mois plus tard, puis leur
correspondance s’espacera pour s’achever par l’annonce du suicide d’Alejandra. Peut-être,
comme il l’écrira dans sa courte lettre, Mandiargues fut-il accaparé par les
problèmes de santé de sa femme ; pour notre part, nous serions plutôt
enclins à penser qu’il prit peur, conscient désormais qu’entre lui et celle
pour qui « Écrire c’est donner du
sens à la souffrance » et attendait la mort comme « une sorte de rencontre fabuleuse », il n’existait pas
de langage commun. La distance entre le vieux dandy enivré par sa virtuosité
stylistique, la cérébralité de ses jeux formels et la jeune fille qui
s’identifiait à Nadja, se sera révélée infranchissable. Cette correspondance semble le récit d’une rencontre finalement
impossible, la lente prise de conscience d’une incompatibilité radicale.
Pour Pizarnik, lectrice passionnée de Saint Jean de la Croix, la
littérature n’est pas un précieux bibelot qu’on sculpte et choie en vue d’une
exposition dans un « musée noir » mais une démarche spirituelle
impliquant l’âme toute entière. Comme Drieu La Rochelle,
elle « mélange le sang et
l’encre » et « pratique la
littérature comme un sport mortel » ; chacun de ses poèmes est
une plongée dans le plus trouble de sa psychè dont elle espère rapporter
quelques vérités premières. Pizarnik ne s’adresse pas
au monde mais vit recluse en elle-même : « Je ne suis rien qu’un
dedans », et ses poèmes font songer à « des petites prisons atmosphériques », des « condensés d’insomnie» (Olga Orozco) ou
les incantations d’une emmurée vivante, celles d’une Erzébet Bathory par
exemple, « la comtesse sanglante », qui la fascinait, et à
laquelle elle consacra un bref récit. Elle évoluait sur un plan supérieur à
celui de Mandiargues pour qui l’exploration de l’inconscient n’était que
prétexte à trouvailles insolites, la mort, un jeu esthétique, l’occasion de
rituels sophistiqués, rien de plus. Pierre Jean Jouve s’agaçait déjà de la
légèreté avec laquelle les surréalistes appréhendaient Thanatos ; cette
objection prend une tournure tragique dans ce dialogue épistolaire. La
fascination pour la mort de Pizarnik est le symptôme d’une réelle impossibilité
à vivre et son œuvre le témoignage de ses apories existentielles ; chaque texte, dans sa brièveté, est, selon Octavio
Paz : « une sorte de point de suture qui tente de refermer cette
plaie ouverte de la naissance et de la vie ». Plus largement,
cette correspondance paraît une allégorie de l’opposition de l’esprit vivant et
de la lettre morte ; en termes Spengleriens, on invoquerait la différence
irréductible entre culture et civilisation.
Pizarnik, de retour à Buenos Aires et pour qui Paris n’était « qu’un prétexte, un lieu d’essai,
juste pour voir si je peux vivre, apprendre à vivre », regrettera la
capitale française. Il est dommage qu’elle n’eut pas l’occasion d’y prolonger
son séjour car y vivaient encore quelques écrivains
susceptibles de la comprendre mieux que Mandiargues : Pierre Jean Jouve
dont la poésie est si proche de la sienne, Georges Bataille peut-être, et
surtout Dominique de Roux alors investi corps et âme dans sa croisade pour
le verbe créateur contre « la lettre morte », et qui, dans « Ouverture
de la chasse », avait justement identifié Mandiargues, parmi d’autres,
comme un défenseur des formes mortes contre lesquelles il luttait. Pizarnik fut une des dernières « mystiques à l’état
sauvage » à s’être approchée du groupe surréaliste après Artaud,
Gilbert Lecomte et quelques autres. Comme eux, elle n’avait pas compris - ou
trop tard - que Breton et sa suite s’étaient depuis longtemps, à leur corps
défendant, « ensablés dans l’âge mûr ». Sans cesser de louer les
suicidés, les maudits, les vagabonds sublimes et « voleurs
d’étincelles », ils s’étaient mués en vendeurs de tableaux, gardiens de
musées, rentiers à vie de leurs juvéniles foucades, à jamais, comme l’avait
prédit Cocteau, « conservateurs de vieilles anarchies ». Du
moins certains furent-ils, à l’image d’André Pieyre de Mandiargues,
d’authentiques esthètes, assez généreux pour se montrer attentifs, jusqu’à un
certain point, aux égarements d’une jeune et grande poétesse.
François GERFAULT