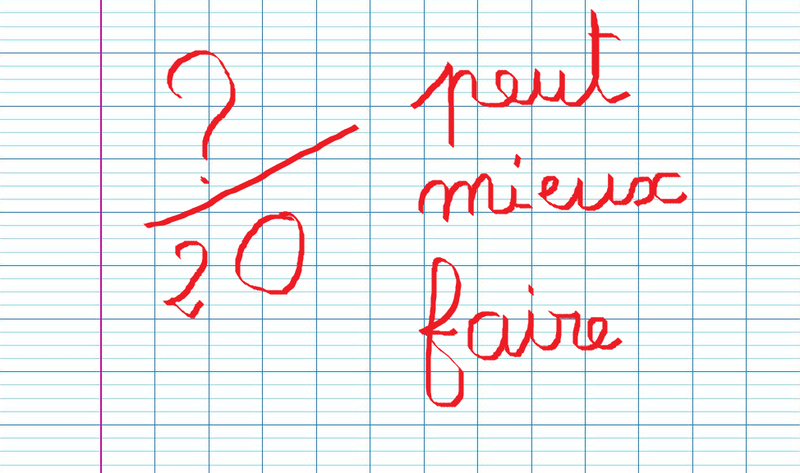Les éditions Folio ont réédité, sous le titre Je suis
sincère avec moi-même, en janvier 2013, des extraits de l’ouvrage de Jacques
Ellul (1912-1994), sorti en 1966 et intitulé Exégèse des nouveaux lieux
communs. L’occasion pour le Professeur du dimanche de revenir sur un
intellectuel en livrant quelques-unes des réflexions tirées d’un ouvrage qui s’inscrit
dans la lignée du Dictionnaire des idées reçues de Flaubert ou L’exégèse
des lieux communs de Bloy.

Jacques Ellul nous avertit que pour déceler les lieux communs en
force, « il faut s’adresser à ces intellectuels bourgeois qui formulent les
vérités de la société de demain, qui fabriquent la bonne conscience par
l’appartenance au futur et la critique du présent (sachant bien d’ailleurs que
ce futur c’est le présent, et que ce qu’ils critiquent n’est qu’une survivance
actuelle d’un passé bien mort !), qui expriment l’assentiment commun au-delà
des fractionnements superficiels de milieux et de professions, qui diffusent les
bons sentiments sur quoi la société prétend s’édifier.[1] »
BIEN-PENSANCE: MODE D'EMPLOI
Jacques Ellul passe alors en revue toute une série de lieux
communs souvent véhiculés par des idiots utiles d’un système qu’ils n’hésitent
pourtant pas à critiquer. Au premier rang de sa critique nous retrouvons tous
les clichés propres à la déferlante nauséabonde du développement personnel. «
Il importe d’être sincère avec soi-même » : « Ce devoir de la sincérité
m’oblige à dire à ma femme que je ne l’aime plus, sans me préoccuper de l’effet
que cela lui fera. Continuer à vivre avec elle, en faisant semblant, ne
serait-ce pas une affreuse hypocrisie ? Me contraindre à quoi que ce soit,
hypocrisie ! Obéir à une valeur, hypocrisie ! Observer une morale qui en effet
m’empêcherait de faire ou d’être ce que j’ai envie de faire ou d’être,
hypocrisie ! Ne pas dire aussitôt son opinion pour la réfléchir, la contrôler,
hypocrisie ! L’important c’est de ne jamais faire semblant, d’être soi-même.[2]
» Hitler non moins que Marc Dutroux ont été sincères avec eux-mêmes, en cela
ils sont en parfait accord avec la ligne préconisée par les manuels de
développement personnel qui pullulent dans nos librairies. On voudrait faire
croire que cette apologie de l’authenticité va de pair avec le souci de la
singularité mais pourtant rien n’est moins faux : « (…) on a envie d’être ce que
le courant social nous fait, et dans cet admirable élan de sincérité, on se
conforme. Il n’est pas étonnant de constater que les groupes où règne ce mot
d’ordre de sincérité avec soi-même sont les plus conformistes possibles.[3] »
Dans la même veine, nous retrouvons cet adage tout aussi creux : «
On est ce qu’on est ». Si l’on suit ce précepte, « je n’ai pas à chercher à
être mieux que je ne suis, car le mieux viendra nécessairement du progrès.
Voici donc le fin mot de cette fière affirmation. Il s’agit d’une démission
dans l’anonyme collectif dont j’attends d’être en quelque sorte débarrassé de
moi-même. Peut-être faudrait-il alors légèrement rectifier la formule : Quand
tu dis "On est ce qu’on est", tu veux dire en fait "Je suis le néant".[4]
Et Jacques Ellul d’enfoncer le clou : « Impeccable logique, adorable harmonie,
la logique du désert, l’harmonie du vide absolu.[5] »
SI LE PEUPLE VOTE MAL, CHANGE DE PEUPLE
Nous retrouvons aussi dans les écrits d’Ellul des lieux communs
sur le peuple, dont on cherche encore la place qu’il peut avoir dans nos
démocraties. Ainsi, « (…) un bon gouvernement, qui pense bien comme il faut, ne
peut pas (…) laisser son peuple se tromper. Il a le devoir de le ramener dans
la juste voie, comme un bon père de famille, etc. (…) Il serait absolument vain
et dangereux de les laisser librement manifester leur volonté par des élections
: ils seraient capables de se tromper sur le sens de l’histoire. Au contraire,
correctement tenus en laisse par le gouvernement, (…) voici que ces peuples,
sans le savoir et sans le vouloir, disposent en réalité d’eux-mêmes, car ils
sont dirigés d’une main ferme vers le moment où, enfin, leur volonté bien
formée se situera ipso-facto dans le sens de l’histoire; à ce moment ils seront
tout à fait libres.[6] » Le refus par le
gouvernement de la prise en compte du référendum sur la Constitution européenne
a le mérite d’illustrer parfaitement cette thèse.
A l’époque où Ellul écrit, la décolonisation est encore dans
toutes les têtes. Loin du manichéisme omniprésent, Ellul observe que le grand
perdant reste toujours le peuple, pris dans des rapports de force indépendants
de sa volonté. Une leçon toujours actuelle à la fois sur la trahison des élites
et les dangers du populisme : « Le peuple n’a pas été favorable au FLN pendant
des années, et il n’était pas hostile aux Français. Mais évidemment, à la
longue, à force d’être exploités et razziés par le FLN, d’être regroupés et
perquisitionnés par les Français, à force d’être égorgés par le FLN et torturés
par les Français, le peuple a bien fini par en avoir marre, le peuple a bien
fini par vouloir quelque chose…Il ne sait pas très bien quoi, sinon que cela
s’arrête. Et alors, il vaut mieux jouer la carte de celui qui en définitive
semble l’emporter, et c’est le FLN ; à ce moment celui-ci peut clamer : « Vous
voyez bien, je représentais bien le peuple algérien !... » Pauvre peuple
algérien. [7]»
TOUT LE MONDE IL EST BEAU
Autre lieu commun : « Si tous les gars du monde… » se tenaient la
main, faisaient la ronde avec une fleur dans la bouche tous nus, eh bien ce
serait chouette parce que se faire des bisous c’est quand même plus mignon que
de se taper dessus. Est-ce bien si sûr ? Est-ce que derrière cette idéologie
des bisounours ne se cache pas au contraire le pire cauchemar de l’humanité ?
Ellul n’y va pas par quatre chemins : « Si tous les gars du monde sont de
braves gars, prêts à s’entendre, s’il n’y a que quelques affreux, cause de tout
le mal, ils doivent porter tout le mal : il suffit de les liquider le plus
rapidement possible ; après ce minuscule lavage de vaisselle, il sera si bon de
faire la ronde autour du monde, enfin purifiés ; laissez donc libre cours à vos
sentiments ; ils nous porteront avec la nécessité de la pesanteur vers le crime
et la justification de nous-mêmes ensuite. L’écœurante mollesse des bons
sentiments fabrique les bourreaux à la chaîne, car ne vous y trompez pas, les
bourreaux sont plein d’idéalisme et d’humanité.[8] »
Enfin nous ne
résistons pas à terminer par quelques remarques de Jacques Ellul, dont le
mélange d’agacement et de provocation limite quelque peu la force
argumentative. Tout d’abord sur le fait que le travail (qui plus est celui des
femmes) rend libre : « J’en veux à celles qui déclarent que l’image de la femme
centre de la maison, éleveuse des futurs hommes et créatrice du foyer n’est
qu’un mythe, expression d’une société et d’un temps localisé. Qu’est-ce qui est
le plus important ? Former des enfants et leur créer une vie véritable ou
percer des trous dans les tickets de métro ?[9] » Nous retrouvons ce même sens
aiguisé des nuances dans ses propos contre le jeunisme, où Ellul gagne un beau
point Godwin : « Place aux jeunes » : «
(…) seuls le fascisme et le nazisme ont mis la jeunesse au premier plan. Où
a-t-on trouvé des ministres de vingt-cinq ans ? Chez les nazis. Où la jeunesse
a-t-elle vécu son aventure à elle ? Sous le IIIème Reich.(…) Il faudrait quand
même que ceux qui se gargarisent
aujourd’hui du Place aux jeunes ! réalisent que si on les prend au
sérieux, cela veut dire : Vive le nazisme ![10] » Zemmour et Finkielkraut
peuvent aller se rhabiller.

[1] Jacques Ellul, Exégèse des nouveaux lieux communs, La table
ronde, 1966, 1994, p.30.
[2] Ibid., p.55.
[3] Ibid., p.56.
[4] Ibid., p.263.
[5] Ibid., p. 54.
[6] Ibid., p.64-65.
[7] Ibid., p.67.
[8] Ibid., p.145-146.
[9] Ibid., p.161.
[10] Ibid., p.280.
Initialement publié sur Apache