Le
peuple ne s'est jamais aussi bien porté. Il se décline sous toutes
les formes, on s'en réclame, on l'exhibe, on le fait
défiler, on
s'en revêt en toute occasion. La dernière collection automne-hiver
du prêt-à-porter du peuple s'appelle « Gilet jaune ».
On connaissait le bonnet phrygien, sa déclinaison médiévale puis
plus récente des bonnets rouges. On avait aussi apprécié le sobre
dépouillement des sans-culottes, puis la nudité inspiratrice de
l'égérie de Delacroix, « qui ne prend ses amours que dans la
populace, qui ne prête son large flanc qu'à des gens forts comme
elle » (Balzac), avant que le rouge prolétarien ne vienne de
Russie rhabiller la volonté du peuple. A chaque époque ses
symboles : le gilet jaune de la sécurité routière est devenu
le symbole d'un peuple qui conchie aujourd'hui le principe de
précaution qui lui pourrit la vie à tout instant tout autant que la
pédagogie dont on lui a trop farci le crâne. A chaque époque ses
barricades : le peuple des gilets jaunes a d'abord dressé les
siennes sur les ronds-points et les péages mais de jacquerie en
révolte puis en révolution, la même question s'est implacablement
posée à tous les Jacques Bonhomme meneurs de fronde :
qu'est-ce que le peuple ?
Au cours de l'Antiquité, les institutions de la démocratie directe se trouvaient enchâssées dans l'écrin protecteur d'une citoyenneté aussi exclusive que restrictive, innovation politique tenant autant aux réformes de Clisthène qu'au collier de l'esclave. A l'époque contemporaine, le problème de la représentation du peuple fut tranché par la terreur jusqu'à ce que l'avènement des systèmes représentatifs permette de formuler une réponse institutionnelle au dilemme impossible : comment représenter tous les peuples qui composent le peuple sans mettre en péril le système de représentation lui-même dès que surgit le moindre antagonisme susceptible de se transformer en conflit ouvert. Les Athéniens avaient tranché à leur manière : sur 300000 habitants, dix pour cent exerçaient une véritable liberté politique et au sein de ces dix pour cent, il n'est guère que ceux qui résidaient dans l'asty, l'espace urbain en lui-même, au sein du vaste territoire de la polis, l'Etat-cité grec, qui participaient réellement au jeu des institutions, dominé par l'influence des grandes familles telles que les Alcméonides. A l'exemple grec s'est opposé le modèle romain, élargissant la citoyenneté à mesure que les conquêtes étendait le territoire de l'empire, jusqu'à faire disparaître ce dernier et à remettre l'idée d'une citoyenneté universelle entre les mains de l'Eglise catholique.
Confrontés
à cette impossibilité historique de la représentation, les
théoriciens du modèle représentatif, au tournant du XVIIIe siècle,
ont eu à cœur de construire un système politique qui autorise à
la fois la participation du plus grand nombre à la vie de la cité
et de ses institutions tout en garantissant à tout un chacun le
respect de ses libertés individuelles et la préservation de sa
sécurité. Là où la conception antique présupposait une scission
claire, que rappelle Hannah Arendt, entre le monde des contingences
matérielles, dont le démos des
citoyens peut se décharger à loisir sur la masse des esclaves, et
le domaine de l’action et de la parole politique, apanage du démos,
les philosophes du contractualisme consacraient l’entrée dans
l’ère des régimes politiques modernes dans laquelle
les sociétés sont
des constructions artificielles s’affirmant comme des agrégats
d’individus et non plus comme des entités collectives à la
manière antique. Cela complique d'autant plus la tâche de ceux qui
entendent théoriser le rapport entre « le » peuple et la
nation. De cette nouvelle difficulté ressort un paradoxe contenu
dans ce que l'abbé Sieyès nommait la « duperie nécessaire »,
soit la théorie de la souveraineté nationale, développée par
Siéyès, dont il résulte que les élus représentent la nation tout
entière et non pas le peuple et qu’ils peuvent donc exercer un
mandat long et non impératif, et n’être guère contrôlés par
leurs électeurs. De l’autre, la théorie de la souveraineté
populaire, prônée par Rousseau et selon lequel, puisque toutes les
décisions ne peuvent être directement prises par le peuple,
l’élection de représentants du peuple est un pis-aller acceptable
seulement si les élus sont considérés comme les commis du peuple :
ils émanent nécessairement du suffrage universel direct, leur
mandat doit être court, il peut être impératif, et ils doivent
être étroitement contrôlés par les électeurs. En pratique,
exception faite du référendum, c’est plutôt la thèse de la
souveraineté nationale qui s’impose aujourd’hui en France, comme
d'ailleurs aux Etats-Unis – on écartera ici le particularisme
britannique et sa « fusion des pouvoirs ».
Ainsi,
comme le notait James Madison, constitutionnaliste américain,
dans The
Federalist Papers1,
les institutions représentatives n'octroient pas le moindre pouvoir
au peuple. Bien au contraire elles « recommandent son
exclusion » pour la bonne et simple raison que « dans un
tel système, il est fort possible que la volonté publique formulée
par les représentants serve mieux l'Intérêt Général que si elle
avait été formulée par le peuple lui-même. » Rousseau le
remarquait avec amertume à propos du système anglais, issu de la
Glorieuse Révolution, dont un Voltaire s'inspire volontiers :
« Le peuple anglais pense qu'il est libre et il a tort ;
il est libre seulement quand il élit les membres du Parlement. Dès
qu'ils sont élus, il est esclave et il n'est rien. »2 Un
siècle après lui environ, Tocqueville remarquera encore que « la
République n'est pas le règne de la majorité, elle est le règne
de ceux qui proclament qu'ils représentent la majorité. »3
Ceux-là
forment ce que Sieyès nomme une “profession particulière”. Et
leur tâche n'est pas seulement de prendre et d'assurer le pouvoir à
travers les élections, elle est aussi de le légitimer. Le pouvoir,
nous dit ainsi Pascal, repose toujours sur l’illusion de la justice
alors qu’en réalité il est la conséquence d’un rapport de
force et maintenu en place par l’imagination. Le souverain a besoin
de pompes et de cérémonie pour asseoir l’idée qu’il est
légitime. Ainsi les magistrats ont-ils besoin de longue robe, les
médecins de sévères lorgnons et les juges de bonnet carrés : «
Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs
hermines dont ils s’emmaillotent en chaffourés, les palais où ils
jugent, les fleurs de lys, tout cet appareil auguste était fort
nécessaire, et si les médecins n’avaient des soutanes et des
mules, et que les docteurs n’eussent des bonnets carrés et des
robes trop amples de quatre parties, jamais ils n’auraient dupé le
monde qui ne peut résister à cette montre si authentique. »
Dans
les nations modernes, la légitimité démocratique du pouvoir repose
sur sur un certain équilibre entre le pouvoir exécutif et le
pouvoir législatif, théorisé par Montesquieu à travers la
séparation des pouvoirs. Cette légitimité repose aussi sur
l'acceptation collective des règles du jeu électoral qui détermine
une origine exotérique et non ésotérique au pouvoir dans les
démocraties libérales contrairement aux Etats totalitaires. Mais la
légitimation du pouvoir repose encore sur quelque chose qui n'est
plus du ressort de l'ordre divin mais conserve tout de même une part
de transcendance en puisant sa source dans le cadre historique et la
geste particulière à chaque Etat-nation, déterminant, selon le mot
célèbre de Renan, un passé et un avenir communs. Comme le souligne
le philosophe Pierre Manent : « La pression homogénéisante, la
destruction de tous les éléments intermédiaires entre l’individu
et la nation fut peut-être plus marquée en France qu’ailleurs,
mais le processus fut le même partout. Il est inséparable du
devenir démocratique des sociétés modernes. Bref, le mouvement
démocratique moderne est inséparable du mouvement national.»
Et
ce mouvement national est aussi roman national,
bien que l'expression fasse grincer de nombreuses dents et heurtent
bien des sensibilités rationalistes. C'est pourtant ce roman
national qui tient ensemble les peuples
qui composent une nation. Et l'on prendra soin ici
d'écrire les peuples,
car en si chaque classe, courant politique, catégorie sociale ou
ethnique développe sa propre conscience historique, il est
impossible qu'elle puisse toutes ensemble prétendre à la
légitimité, de la même manière qu'une seule d'entre-elle peut
difficilement prétendre faire naître d'elle-même la légitimité à
dominer toutes les autres. Cette légitimité ne peut passer qu'au
tamis de la nation, et à travers elle au tamis de l'histoire, et
elle est en même temps le produit d'un consensus incessamment
reproduit par le jeu électoral, accepté sur la base d'un cadre de
civilisation commun et garanti par des dirigeants qui doivent
démontrer leur volonté de préserver ce cadre, ainsi que la liberté
et le sentiment d'adhésion de celles et ceux qui y vivent. Quand ces
éléments ne sont plus réunis, alors on voit à la fois les règles
collectives être violemment contestées et l'unité garantie par le
consensus national se fragmente alors à nouveau en divers groupes
dont chacun peut se prétendre garant de la préservation d'un cadre
de civilisation commun au nom de revendications particulières.
C'est
exactement ce qu'il s'est passé en 2017. Au ressentiment accumulé
depuis plus de vingt ans à l'égard d'élites politiques incapables
de reconnaître et donc de maintenir l'illusion du pouvoir à
laquelle elles doivent pourtant tout, s'est ajouté lors des
élections présidentielles la remise en cause des règles
collectives de légitimation par le pouvoir lui-même. En clair, les
élections ont été une vaste blague et tout le monde s'en est
aperçu. En cela d'ailleurs, le “vote volé” lors de la
consultation référendaire de 2005 à propos du traité
constitutionnel européen avait été un précédent fâcheux qui
avait préparé le décrochage auquel nous assistons maintenant. Et
il a suffi qu'Emmanuel Macron, qui avait capté à son profit une
partie des énergies liées au mouvement “dégagiste”, se révèle
en dix-huit mois un monarque pris lui-même suffisamment au piège de
l'illusion du pouvoir pour que le roi, soudain, se révèle nu aux
yeux de tous.
La situation présente confronte tout un chacun, du politique au citoyen lambda, à la question on ne peut plus dangereuse qui ouvrait cet article : qu'est-ce que le peuple ? Car si le mouvement des Gilets jaunes se présente volontiers comme le peuple face aux élus, impuissants, cyniques et corrompus, de la nation, on ne sait pas, et les Gilets jaunes ne peuvent pas savoir eux-mêmes, quel peuple ils représentent pour la bonne et simple raison qu'ils en représentent plusieurs à la fois. Est-ce le peuple de droite, trahi par Giscard et la droite libérale en 1974 ? Est-ce le peuple de gauche, trahi par Mitterrand en 1983 ? Est-ce, comme le pense un éditorialiste, le peuple des petits entrepreneurs, des salariés et des artisans contre les “fonctionnaires et les privilégiés” ? Est-ce au contraire le peuple des fonctionnaires – ambulanciers, flics, profs, pompiers – qui ont eux-mêmes les meilleures raisons de se considérer comme le peuple en colère ? Est-ce encore le peuple des retraités qui protestent contre leurs retraites amputés ou celui des jeunes chômeurs qui accusent à bon droit les retraités d'avoir largement profité des Trente Glorieuses et de se comporter aujourd'hui comme les pires des égoïstes Les seules réponses qui aient été trouvées dans l'histoire pour résoudre la question du peuple furent celles de la démocratie antique, reposant sur l'esclavage, celle de la monarchie de droit divin et pour finir celle de la nation. Nous ne vivons plus ni dans l'Antiquité, ni sous une monarchie de droit divin. Il ne nous reste comme solution pour rassembler les peuples en un seul, que la nation. Mais une nation ne se décrète pas aussi facilement. Toute nation a besoin d'un moment fondateur comme d'une référence à un passé commun pour se constituer. Or, nos sociétés modernes semblent cultiver une indifférence pour leur passé qui est inédite dans l'histoire de l'humanité et nos élites, depuis trente ans, proposent avec la construction européenne non pas un acte fondateur mais une fuite en avant qui n'intéresse plus grand-monde en France et suscite même une détestation commune qui est l'un des rares ferments d'unité de cette contestation multiformes qui a surgi depuis plusieurs semaines. Comme le notait encore Pierre Manent il y a déjà six ans : « Ayant discrédité gouvernements corrompus et peuples paresseux, la gouvernance européenne rencontrera sa propre faiblesse intrinsèque, qui réside en ceci qu’elle n’offre aux citoyens que la perspective d’une course indéfinie à la poursuite d’un horizon toujours repoussé, sous le contrôle de critères arbitraires venus d’on ne sait où, administrés par des bureaucrates sans visage à la compétence de qui l’on est obligé de croire. » Fiction de gouvernement universelle régnant désormais sur une fiction de nation où la mesure du monde se réduit au Soi et à l'Entre-Soi malgré les antiennes inlassablement répétées à la gloire du "Vivre-Ensemble" auquel personne n'aura aussi peu cru qu'aujourd'hui.
David Vela Cervera. Libertad guiando el Pueblo
1 1787
3 De
la Démocratie en Amérique. T.
1. 1835





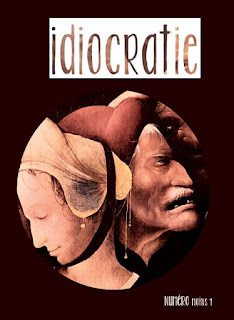
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire